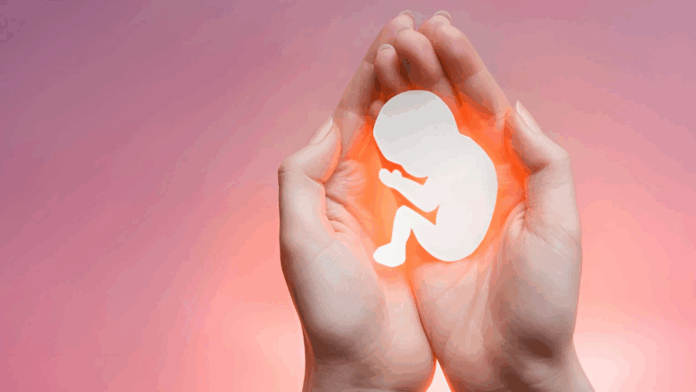Eric Bertinat – Alors que dans de nombreux pays le droit à l’avortement recule, la Suisse prend une direction opposée. Dès 2027, les interruptions volontaires de grossesse (IVG) seront entièrement couvertes par l’assurance maladie, une mesure incluse dans le «paquet de maîtrise des coûts 2» adopté par le Parlement. La décision a été prise sans réel affrontement politique et n’a suscité aucune opposition de la part des partis conservateurs.
Un « jalon » salué par la gauche
Pour Mattea Meyer, coprésidente du Parti socialiste, cette avancée constitue un signal fort: «Nous vivons actuellement un véritable retour en arrière en matière d’égalité. Le droit à l’autodétermination des femmes sur leur propre corps est de plus en plus attaqué par les milieux de droite.» Même au sein du PLR, le soutien est assumé. Bettina Balmer, présidente des Femmes PLR, souligne que «dire oui au délai imparti pour recourir à une IVG implique aussi de reconnaître cette procédure».
Si la Suisse autorise l’avortement dans les douze premières semaines, de nombreuses femmes se heurtent encore à quelque résistance. Certains médecins refusent de les accompagner pour des raisons religieuses ou tentent de les culpabiliser. Des cliniques privées, comme l’hôpital Bethesda à Bâle ou la Hirslanden St. Anna à Lucerne, refusent purement et simplement de pratiquer des IVG, sauf cas médicaux extrêmes.
Helene Huldi, présidente d’APAC-Suisse, l’organisation des prestataires professionnels de services et d’informations sur l’interruption de grossesse et partenaire de SANTÉ SEXUELLE SUISSE, confirme que «l’avortement reste un sujet tabou et la stigmatisation est forte. De nombreuses femmes médecins pratiquent des interruptions médicamenteuses, mais ne le rendent pas public par crainte d’être stigmatisées». Dans certaines régions, comme la Suisse centrale, des patientes préfèrent même se rendre à Zurich pour obtenir une prise en charge anonyme.
Un combat politique récurrent
Depuis quarante ans, la question de l’avortement a régulièrement été soumise au peuple :
1985 : Initiative « Droit à la vie » rejetée par 69 %. Elle visait à inscrire dans la Constitution la protection de la vie dès la conception.
2002 : Régime du délai accepté par 72 %. Ce système autorise l’IVG dans les 12 premières semaines.
2002 : Initiative « Pour la mère et l’enfant » rejetée par 82 %. Elle cherchait à interdire quasiment toute IVG.
2014 : Initiative « Financer l’avortement est une affaire privée » rejetée par 70 %. Elle proposait de supprimer le remboursement par l’assurance de base.
2023 : Initiative parlementaire Léonore Porchet (Verts/VD) rejetée au Conseil national. Elle voulait sortir l’avortement du code pénal et le traiter comme une question de santé.
Du côté des personnalités politiques, Barbara Haering-Binder (PS) s’est illustrée dans les années 1990 en défendant la solution du délai, tandis que Léonore Porchet continue aujourd’hui de militer pour une dépénalisation totale. Face à elles, Jean-Luc Addor (UDC), Andreas Gafner (UDF) ou Andrea Geissbühler (UDC) défendent régulièrement des restrictions, soutenus par des organisations comme 1000Plus Schweiz.
Le combat américain et la pilule abortive
Aux États-Unis, l’arrêt Dobbs de 2022 a ouvert la voie à des interdictions quasi totales dans une douzaine d’États. Mais malgré ce recul légal, le nombre d’avortements a augmenté : 1’033’000 en 2023, selon l’Institut Guttmacher, son plus haut niveau depuis plus de dix ans. La raison ? La montée en puissance de la pilule abortive, désormais utilisée dans près de deux tiers des cas. Facilement distribuée par courrier, elle contourne les lois restrictives et permet aux femmes d’avorter même dans des États hostiles comme le Texas. Deux ans après Dobbs, le mouvement anti-avortement peine ainsi à enrayer cette évolution.
Une tendance mondiale restrictive
La décision suisse se démarque d’une dynamique globale de durcissement. En Pologne et en Hongrie, l’accès à l’avortement s’est considérablement restreint. Dans ce climat, la voix du Vatican continue de peser.
Le pape François dénonçait déjà la «culture du jetable» pour condamner l’avortement et l’euthanasie. Son successeur, le pape Léon XIV, a repris le flambeau en rappelant que «les enfants à naître jouissent de la dignité de créatures de Dieu» et que les gouvernements doivent bâtir leurs sociétés en s’appuyant sur la famille, définie comme «l’union stable entre un homme et une femme».
Si la décision d’inclure totalement l’IVG dans la couverture de l’assurance maladie a été saluée par les partis progressistes, elle suscite une profonde déception dans les milieux conservateurs et religieux. Pour eux, cette mesure banalise un acte qu’ils considèrent comme une atteinte à la vie. Plusieurs associations pro-vie regrettent également le manque de débat public autour de cette évolution majeure : le Parlement a tranché sans grande discussion et la presse en a à peine fait écho.
Ce qui surprend surtout, soulignent-ils, c’est que l’avortement soit désormais pris en charge comme s’il s’agissait d’un traitement médical ordinaire, alors même que la maternité n’a jamais été considérée comme une maladie. À leurs yeux, la Suisse a franchi un pas lourd de conséquences, en validant par le financement public non seulement la légitimité, mais aussi la normalisation de l’avortement.