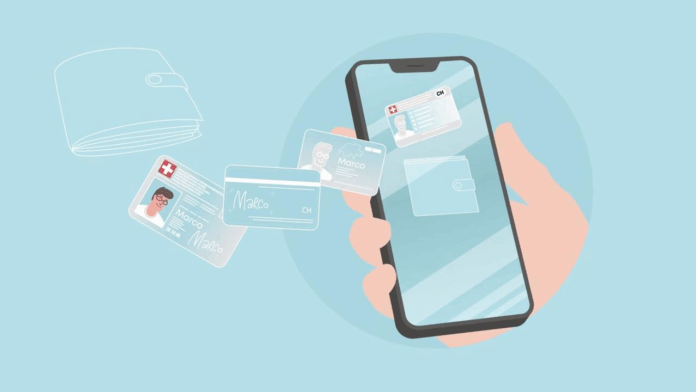Lena Rey – Acceptée de justesse par 50,4 % des votants, l’identité numérique suisse se présente comme un outil facultatif et moderne destiné à nous simplifier la vie. Mais derrière cette façade se cachent à la fois des conflits d’intérêts financiers et une question beaucoup plus profonde : que devient notre humanité quand l’échange direct est remplacé par le tout numérique ?
On nous rassure en disant que l’e-ID sera « facultative ». Mais souvenons-nous du billet de train papier. Alors qu’au moment du développement de l’application pour l’achats des titres de transport, on nous avait promis que le papier serait maintenu, on apprend maintenant qu’il est déjà voué à disparaître. Souvenons-nous également du pass Covid, facultatif en théorie, mais indispensable pour voyager, aller au restaurant, et même travailler. La pente est connue : ce qui commence comme une option devient vite une obligation.
Au-delà des failles de sécurité potentielles, la question est moins technique que spirituelle. Car derrière les logiciels et les algorithmes, c’est un modèle d’homme qui s’impose : un être réduit à un code, à une identité vérifiable, à une clé d’accès aux services publics et sociaux. En ce sens, réduire l’« identité » à une e-ID n’est pas neutre : c’est passer d’un mot qui, depuis son origine latine (identitas), exprimait la fidélité de l’être à lui-même, à un simple identifiant impersonnel. La personne n’est plus accueillie dans sa chair et sa parole, mais filtrée, validée. Le risque est de basculer vers un monde où la liberté n’existe que pour ceux qui montrent patte blanche numérique.
Le danger n’est pas seulement celui d’une surveillance politique, à la manière du crédit social chinois. Il est plus intime – celui d’une perte progressive de notre humanité. Car qu’est-ce qui fait de nous des hommes et des femmes, sinon la capacité de nous rencontrer et de dialoguer sans écran comme intermédiaire ? Si chaque relation passe désormais par un identifiant numérique, alors c’est l’âme de notre société qui s’étiole.
La technologie doit servir la personne, et non l’inverse. Or, on constate de plus en plus que ces outils effacent le lien et creusent l’isolement. Même si elle semble futuriste, dystopique et folle, il ne faut perdre de vue la tentation transhumaniste qui pointe derrière l’e-ID : croire que l’homme peut s’augmenter en se numérisant, alors qu’il se réduit en vérité.
À cela s’ajoute une dimension scandaleuse. Le mandat pour la brique technique de l’e-ID a été attribué à ELCA, entreprise déjà controversée pour avoir racheté Serafe (collectrice de la redevance audiovisuelle), avoir engrangé des millions de dividendes et obtenu divers mandats publics sensibles, jusqu’au suivi de la vaccination Covid. On retrouve la même société au cœur d’un projet qui touche cette fois à l’identité de chaque citoyen. Et comme si cela ne suffisait pas, Swisscom – détenue majoritairement par la Confédération – a versé de l’argent à la campagne du « oui », brouillant dangereusement la frontière entre neutralité publique et intérêts privés.
Mais au-delà des chiffres et des magouilles, c’est une autre question qui doit nous alerter :
À quoi sert-il à l’homme de gagner le monde, s’il vient à perdre son âme?». À l’heure où le tout numérique devient la seule norme, cette parole de l’Évangile sonne comme un avertissement.