Eric Bertinat – Selon le rapport 2025 de l’Aide à l’Église en Détresse, plus de 360 millions de chrétiens vivent aujourd’hui dans des pays où la pratique de leur foi est considérée comme dangereuse. Parmi eux, les catholiques subissent une pression croissante, souvent diffuse, parfois brutale. Si les images spectaculaires de violences en Afrique ou en Asie attirent ponctuellement l’attention, la réalité quotidienne d’une persécution plus discrète s’étend bien au-delà des zones de guerre.
En Afrique subsaharienne, la montée des groupes armés islamistes transforme la foi catholique en cible stratégique. Au Nigeria, des prêtres sont enlevés presque chaque semaine ; les villages chrétiens du centre et du nord vivent dans la peur des attaques nocturnes. Au Mozambique, des paroisses entières ont été incendiées. En République démocratique du Congo, le sanctuaire devient parfois le dernier refuge pour des civils traqués. Ces violences ne sont pas de simples incidents : elles visent à effacer une présence, une mémoire, une identité.
En Asie, la situation est plus subtile mais tout aussi préoccupante. En Chine, le contrôle du Parti sur les Églises dites «officielles» rend toute pratique religieuse indépendante suspecte. Les catholiques fidèles à Rome vivent sous surveillance, entre fidélité spirituelle et prudence politique. En Inde, les tensions communautaires alimentées par l’hindouisme nationaliste se traduisent par des agressions et des campagnes de désinformation. Dans certaines régions, être catholique, c’est désormais vivre dans la méfiance du voisinage.
En Europe, le contexte est évidemment très différent : nul ne risque sa vie pour aller à la messe. Pourtant, une autre forme de marginalisation s’installe, plus insidieuse. Dans plusieurs pays, les symboles religieux sont relégués au nom d’une laïcité interprétée de manière très restrictive par la gauche. Des enseignants ou des élus hésitent à évoquer leur foi publiquement, de peur d’être jugés prosélytes ou rétrogrades. La pratique religieuse se retire du paysage visible, confinée dans la sphère privée. Cette «invisibilisation» culturelle, bien que sans violence physique, interroge sur la place réelle du catholicisme dans les sociétés occidentales.
Ce qui attriste davantage encore, c’est le silence persistant de la presse internationale. Rares sont les grands médias à consacrer des enquêtes suivies à ces violences, comme si le sort des catholiques ne méritait ni indignation ni une place dans l’actualité mondiale. Ce manque d’écho renforce le sentiment d’abandon ressenti par ceux qui vivent leur foi dans la peur ou la clandestinité. L’indifférence devient alors une seconde persécution : plus douce, mais tout aussi dévastatrice.
Entre la brutalité des attaques au Sud et l’effacement symbolique au Nord, le catholicisme mondial traverse une même épreuve : celle d’être du témoignage et de la fidélité au Christ. Loin des projecteurs, des croyants continuent de prier, d’enseigner, de servir les plus pauvres, souvent dans des conditions extrêmes : ne les oublions pas dans nos prières !


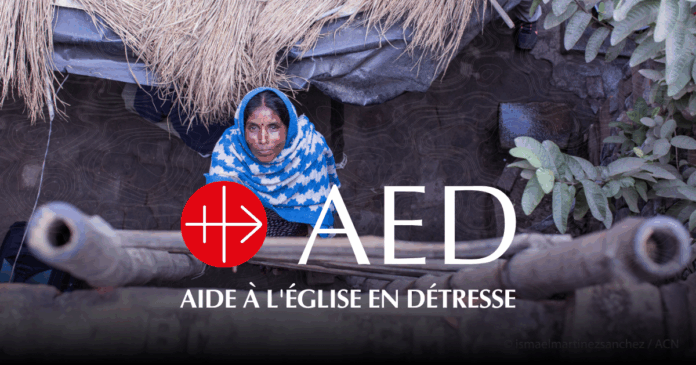
La situation des Chrétiens dans le monde est une catastrophe. Surtout depuis l’arrivée de l’Islam. Ne pas oublier les autres Chrétiens évangéliques, protestants, maronites, orthodoxes, …. Et c’est bien pire que celle de Gaza que les médias mainstreams oublient volontairement !